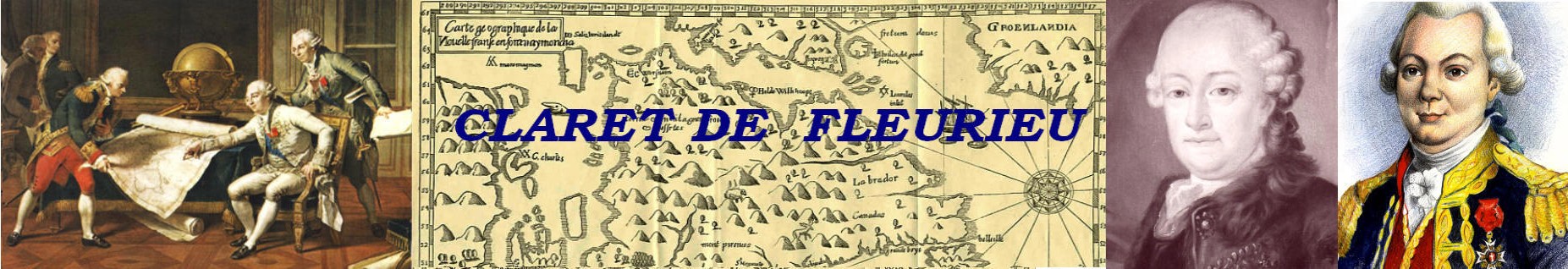
Retour au menu cliquez ci-dessus.

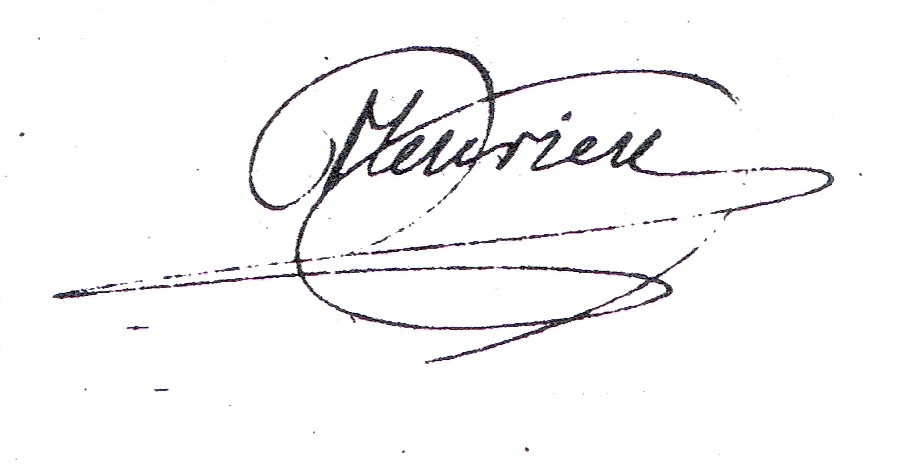
Charles-Pierre Claret de Fleurieu
Sa Carrière sous l'Ancien régime:
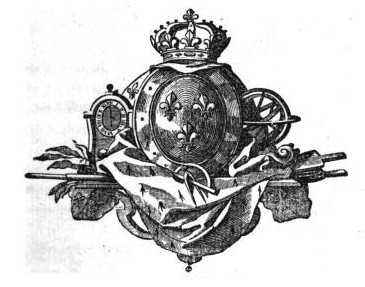
Dernier fils de Jacques-Annibal, Charles Pierre est né à Lyon le
3 juillet 1738 et
baptisé en l'église d'Ainay.
Il
fut le plus célèbre et encore aujourd'hui le plus connu des Claret de
Fleurieu. Il est le cadet d'une famille de 9 enfants.
Éduqué par un prêtre Jésuite à Lyon, l'Abbé Pernety, qui était membre de
l'Académie, il apprit grâce à lui les langues: l'anglais, le portugais et
l'italien.
Il refuse très tôt sa destinée ecclésiastique et choisit la marine, chose fort
étrange pour quelqu'un de si loin de la mer! Il
commence ses études supérieures très jeune, et dès le collège, il se fait connaître à Lyon
par une thèse brillante qui annonçait sa vocation et qui avait pour objet
"l'application des mathématiques à l'art nautique".
Engagé en 1752 en tant que garde de la marine à la compagnie de Toulon dés l'age de 13 ans et demi, le 31 octobre 1755, il participe aux campagnes de la guerre de sept ans qui se termine en 1763, et participe ainsi aux combats de Mahon, Lagos, et des Sablettes, ils lui valurent successivement les grades de brigadier à la compagnie des gardes de la marine, et d'enseigne de vaisseau.[1]
Pendant ce temps en 1761, bien qu'absent à Lyon pour le service du Roy, Charles-Pierre fut nommé, membre de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, cette compagnie l'ayant considéré comme domicilié de droit chez son père. Nommé le 1er juillet 1765 Enseigne de port, il fut envoyé le 27 du mois à Paris pour étudier l'horlogerie marine avec Berthoud.
 Il
éprouve lors d'une campagne en mer d'une année, la première montre marine à
secondes que Ferdinand Berthoud a inventé avec lui, laquelle facilite le calcul des
longitudes. C'est Charles-Pierre de Fleurieu qui a monté de ses mains la première.
Il
éprouve lors d'une campagne en mer d'une année, la première montre marine à
secondes que Ferdinand Berthoud a inventé avec lui, laquelle facilite le calcul des
longitudes. C'est Charles-Pierre de Fleurieu qui a monté de ses mains la première.
Cette tâche était un enjeu
politique et scientifique majeur dans la course aux connaissances maritimes
contre l'Angleterre. Les rivalités étaient nombreuses elles aussi, par exemple
avec M. Leroy, horloger du
roi.
Finalement la confiance du Roi était donc donnée à Charles-Pierre et Berthoud. L'expérimentation
de l'horloge se fit lors de la
campagne de la frégate de 20 canons "l'Isis" dont le commandement fut confié à Charles Pierre Claret
de Fleurieu de novembre 1768 au 11 octobre 1769.
 La
montre pratiquement invariable indiquait l'heure d'après le moment du départ du
bateau, comme s'il était resté à quai. Connaissant ensuite par l'astronomie
l'heure réelle sur le bateau, à l'endroit où il se trouve, on peut facilement
déterminer sur la carte la position exacte du navire et sa longitude. Cette
avancée maritime était considérable, comparable aujourd'hui à une grande
découverte comme celle des coordonnées satellites GPS.
La
montre pratiquement invariable indiquait l'heure d'après le moment du départ du
bateau, comme s'il était resté à quai. Connaissant ensuite par l'astronomie
l'heure réelle sur le bateau, à l'endroit où il se trouve, on peut facilement
déterminer sur la carte la position exacte du navire et sa longitude. Cette
avancée maritime était considérable, comparable aujourd'hui à une grande
découverte comme celle des coordonnées satellites GPS.
Le résultat de
ses observations fut publié en 1773 « Voyage fait par ordre du
roi, pour éprouver les horloges marines » on peut citer d'autres grandes oeuvres
comme le Neptune du Nord ou Atlas du Cattegat et de la Baltique qui lui prit 25
ans.
A droite: M Berthoud,
Ci dessus: La montreMarine.
Charles-Pierre Claret de Fleurieu
Fleurieu est nommé Lieutenant de vaisseau le 1er octobre 1773, puis inspecteur en second des cartes et plan de la marine, et inspecteur adjoint de l'académie de marine le 15 Mai 1776. En 1775 Charles-Pierre est fait chevalier de Saint-Louis.
Présenté au roi, il fut nommé capitaine de vaisseau le 5 décembre 1776 et
aussitôt après directeur des ports et arsenaux en Janvier 1777 ; fonction crée
en sa faveur par Louis XVI. Il choisit comme adjoint en 1783 son ami M
d'entrecasteaux.
Cette fonction consistait à gérer tout le matériel, les travaux et surtout le mouvement de la flotte. Charles-Pierre occupera ce poste 15 ans.
C'est de cette place qu'il a dirigé presque tous les plans d'opérations navales de la guerre de 1778 à 1783 contre l'Angleterre, pour la guerre d'indépendance des USA.
C'est également lui qui a convaincu Louis XVI dans son rapport, de lancer l'expédition de La Pérouse.
Le 15 février 1785 il rédige les premières instructions du voyage de La Pérouse et le 26 juin 1785 il rend les instructions définitives, après annotations de Louis XVI en personne. Tous les autres voyages de découvertes de cette période porte son emprunte.
La Pérouse était un ami intime de Fleurieu et ils échangèrent une correspondance précieuse à l'Histoire, pendant le voyage de découverte, voyage qui se terminera par un drame en 1788 dans l'île de Vanikoro.
Jacques Blamont dans son livre "Vénus dévoilée", évoque Fleurieu comme une sorte de "super barbouze" de Louis XVI qui s'occupait de missions mystérieuses, agissant dans les coulisses du pouvoir quelque soient les ministres de la marine. Il est vrai que Fleurieu a toujours agit dans l'ombre et souvent à la place du Ministre de la Marine et directement aux ordres de Louis XVI. L'exemple le plus flagrant est le voyage de La Pérouse qu'il organisa entièrement sans intervention de Sartine.
L'auteur pense même qu'il s'occupait de l'espionnage technique de l'Angleterre. En effet, Fleurieu a eu souvent affaire à "la perfide Albion", l'ayant battue deux fois, la première lors de la construction de la montre marine à seconde avec Ferdinand Berthoud, la seconde lors de l'établissement des plans de la guerre d'Amérique. Il eu enfin affaire à l'Angleterre lors de son enquête sur la tristement célèbre défaite de Trafalgar demandée par Napoléon. Bien entendu son rôle de ministre de la marine l'a confronté en permanence non seulement à l'Angleterre mais aussi au reste du monde. Napoléon fera perquisitionner les collections et le domicile de Fleurieu après sa mort, peut être pour y découvrir des documents secrets?

Sous la révolution:
Fleurieu est nommé par le Roi, Ministre de la Marine et des Colonies le 27 octobre 1790 à la place de M. de La Luzerne. Dès sa nomination, MM. Borie et Gandon jacobins de Brest, transmettent au nouveau ministre "le procès-verbal de la visite faite à bord des vaisseaux du Roi par la société des amis de la constitution et leur janissaires". Fleurieu est confronté directement à la sédition de la Marine pourtant chère au Roi, quand il remarque que le nom de ce dernier n'a même pas été prononcé dans le rapport.
Fleurieu commence le 28 octobre 1791 son mandat en adressant les remontrances suivantes: "Je ne puis que vous renouveler le témoignage de la satisfaction du Roi sur les marques de zèle que les citoyens ont donné, et sur l'heureux effet qu'elles ont produit. Je dois cependant vous observer que j'ai remarqué avec peine que, dans les discours tenus aux équipages, pour les rappeler à la subordination qui pouvait seule leur mériter l'indulgence dont ils avaient besoin, ou ne leur a parlé que de l'assemblé nationale, sans leur retracer, en même temps, les sentiments d'amour et de reconnaissance que tous les français doivent à un monarque qui a tant fait pour leur bonheur, et qui, étant le chef suprême de l'administration, doit conserver toute l'influence et toute l'autorité dans l'exécution des lois."
Cependant, le jour même, les jacobins de Brest faisaient savoir à l'assemblée qu'il n'appliquerait pas aux mutins le code de discipline en vigueur dans la Marine. Les mutins pouvait détruire la discipline et donc la flotte française en toute impunité. Les mutins étaient même encouragés par les commissaires et l'assemblée. Cette situation entraîna la démission d'une grande partie des officiers de marine, non remplacés par la suite. La conséquence de l'irresponsabilité de ces prétendus patriotes se fera sentir 15 années plus tard, lors de la destruction de la flotte française à Trafalgar le 21 octobre 1805.
Les commissaires jacobins de Brest voulaient un "général agréable" à la Place d'Hector, Fleurieu leur envoya donc M. de Bougainville le 8 novembre 1790 afin de reprendre la flotte en main. Bougainville était alors célèbre pour sa conduite "humaniste" envers les indigènes. A peine arrivé, Bougainville doit faire face le 18 novembre à une nouvelle mutinerie menée par 17 matelots sur l'América, le foyer de la sédition navale. Bougainville punit les matelots après l'intervention de la Garde Nationale. Le corps municipal leur donna une simple réprimande. Bougainville essaya toutefois de maintenir l'ordre tant bien que mal en allant jusqu'à inviter les jacobins aux cérémonies officielles comme celles de l'emplacement du nouveau drapeau.
Au vu du contexte, Fleurieu n'avait que très peu de maîtrise sur le fonctionnement de la Marine, une absence de pouvoir qui l'obligea à démissionner.
Fleurieu et le roi souhaitaient également séparer la marine des colonies, mais l'assemblée fut d'un avis contraire. Une atmosphère de complot régnait aussi à l'assemblée où les Jacobins voulaient remplacer le ministre de la Marine par un de leurs affidés.
En conséquence, le 15 avril 1791 Charles-Pierre donne sa lettre de démission à louis XVI.
Toutes ces péripéties retardèrent l'expédition de son ami
d'Entrecasteaux pour rechercher La Pérouse. Ce qui sans doutes
affecta beaucoup louis XVI. L'expédition pourra cependant partir. La riche
correspondance entre Charles-Pierre et d'Entrecasteaux fait foi d'une grande
amitié entre les deux "collègues", et démontre les difficultés rencontrées à
l'époque pour monter cette fameuse expédition.
Le Contre-amiral, d'Entrecasteaux
appareille de Brest le 28 septembre 1791 avec les frégates La Recherche
et L'Espérance. Il mourra hélas trot tôt (il est mort du scorbut le 20
Juillet 1793), pour rendre compte de la richesse de cette nouvelle expédition.
Cette démission fut amèrement acceptée par la marine.
De nombreuses protestations s'en
suivirent. Par exemple, les commissaires députés
des invalides envoyèrent une lettre de réclamation au Roi le 23 Avril 1791, le
doyen des ministres, M. Bretel, fit également une réclamation pour son maintient le 3 Mai
1791, en vain.
Le Roi accepta la démission non sans mal le 17 mai 1791.
 Un
peu moins d'un an plus tard, le 18 Avril 1792
[2],
Charles-Pierre
est nommé gouverneur du "Prince-Royal".
Il
ne rejoindra que tardivement son poste car l'assemblée était réticente, et fit
traîner la nomination. La chute de la monarchie arriva trot tôt pour que
l'affaire soit totalement réglée, plus clairement il commença sans l'accord de
l'assemblée.
Un
peu moins d'un an plus tard, le 18 Avril 1792
[2],
Charles-Pierre
est nommé gouverneur du "Prince-Royal".
Il
ne rejoindra que tardivement son poste car l'assemblée était réticente, et fit
traîner la nomination. La chute de la monarchie arriva trot tôt pour que
l'affaire soit totalement réglée, plus clairement il commença sans l'accord de
l'assemblée.
Le 10 Août 1792, amorce la chute de la monarchie constitutionnelle, Charles-Pierre était resté aux Tuileries pour soutenir Louis XVI dans son malheur. Il échappa au massacre des gardes suisses par miracle. Il tenait la Reine par le bras au moment de l'invasion des Tuileries, et accompagna Louis XVI jusqu'a l'assemblée où il ne put entrer. Ces détails importants nous laissent à penser que Charles-Pierre avait accès à la plus grande intimité de la famille royale, et que des liens étroits s'étaient tissés entre Fleurieu et elle.
Madame de Fleurieu quant à elle fut revêtue d'un costume de femme de chambre et fut reconduite à son hôtel, 18, rue Taitbout, par un laquais sans livrée. Une fois réuni, le ménage se réfugia à la campagne, mais Charles-Pierre retournera vite avec sa femme à Paris pour ses recherches.
Portrait
du Dauphin de France.
Fleurieu a eu une chance incroyable lors de ces événements, on peut expliquer cette félicité par la discrétion que Fleurieu a su de tout temps cultiver.
Après les événements Charles - Pierre s'occupait dans son hôtel de la rue Taitbout pour terminer ce que Louis XVI lui avait demandé: les cartes du Catégat de la Baltique. Afin d'achever cette oeuvre, il avait transformé un étage entier de son hôtel en atelier de recherches mécaniques et scientifiques. Ces recherches étaient ralenties par les événements, elles coûtaient cher et Fleurieu devenait de plus en plus pauvre. Comble du malheur, l'héritage de son frère qui était une grande espérance pour Fleurieu était en assignat, monnaie qui ne valait plus rien.
 Charles
Pierre est arrêté une première fois le 7 Septembre 1793, en pleine terreur.
Il est envoyé à la prison des Madelonnettes rue des Fontaines du Temple. Son
hôtel de la rue Taitbout est mis sous scellé.
Charles
Pierre est arrêté une première fois le 7 Septembre 1793, en pleine terreur.
Il est envoyé à la prison des Madelonnettes rue des Fontaines du Temple. Son
hôtel de la rue Taitbout est mis sous scellé.
Cette arrestation, bien que fantaisiste de la part du comité du sûreté générale est sans doute due malgré tout à une lettre que Louis XVI avait envoyé à l'assemblée nationale et qui fut publiée le 19 Avril 1791 dans le moniteur universel.
Ci-dessus: La prison des Madelonnettes.
Dans cette lettre élogieuse, Louis XVI avait fait la première demande de nomination de Charles pierre comme gouverneur du Dauphin.
L'autre "charge" qui aurait pu faire grief à Fleurieu est un dessin envoyé par Louis XVI, représentant ce dernier à la conciergerie avec le Dauphin sur ses genoux.

Charles-Pierre fut relâché presque aussitôt après son arrestation, par manque de preuve. La raison de cette libération est la suivante: la loi était encore trop restrictive pour les "patriotes".
En effet le 7 septembre 1793, jour de l'arrestation de Fleurieu, les comités révolutionnaires étaient bel et bien excités par la déclaration officielle de la terreur du 5 septembre précédant. L'arrestation préventive fut donc instaurée par la république 10 jours plus tard, soit le 17 septembre 1793 via la loi des suspects.
Toujours est il qu'il que Fleurieu est assigné à résidence avec sa femme dans leur hôtel de la rue Taitbout. Mais hélas! Le 21 avril 1794, les révolutionnaires reviennent arrêter Fleurieu et sa femme sur ordre d'un décret d'arrestation de la part du Comité.
Ce jour là, l'arbitraire révolutionnaire a tourné au ridicule. En effet, les républicains se sont rendus compte avec stupeur qu'ils arrêtaient quelqu'un qui était déjà assigné à résidence. Ils s'étaient trompé de Fleurieu! Le fameux mandat d'arrêt concernait le neveu de Charles Pierre: Jean-Jacques de Fleurieu. Pour arrêter ce dernier, les révolutionnaires sont allés jusque dans l'Ain, mais ne l'ayant pas trouvé là bas, ils sont aller le chercher rue Taitbout. Ils repartirent donc bredouille, car ils ne purent que constater que leur homme était absent.
Les révolutionnaires furent sans doute furieux de cet échec et revinrent une dernière fois le 6 mai 1794 avec un ordre d'arrestation en bonne et due forme. Cependant le motif d'arrestation était vraiment inexistant.
Ce 6 mai 1794, les révolutionnaires enfermèrent donc Charles-Pierre de Fleurieu et sa femme Aglaé à la maison d'arrêt de la section révolutionnaire des piques. Aglaé de Fleurieu était alors enceinte de deux mois lors de son arrestation.
Fleurieu est resté silencieux en prison jusqu'a 3 mois après le 9 thermidor: le 27 septembre 1794. Il écrivit ce jour là un mémoire pour obtenir sa libération, cette véritable autobiographie fut retrouvée chez des révolutionnaires après la tourmente. Son affaire fut mise en délibérée le 13 octobre 1794. Le couple pu enfin recouvrir la liberté une semaine plus tard.
Monsieur et Madame de Fleurieu furent donc libre, mais ce fut pour retrouver leur foyer au patrimoine dissipé, leur mobilier dispersé, leurs ressources anéanties. Vous l'avez compris, le bel hôtel de la rue Taitbout fut entièrement pillé par les républicains.
Aglaé était encore enceinte, le premier enfant du couple était un fils. Il est mort-né juste après leur libération.
Malgré le fait que la mortalité infantile était importante à l'époque, il est certain que la mort prématurée de l'enfant a été facilitée par la grossesse en prison.

Portrait de Barras.
Sous le directoire
Libre mais sans ressources,
Charles-Pierre a besoin de travailler pour survivre et pour poursuivre ses
ouvrages. L'opportunité de reprendre du service lui est donné en 1795 (An III).
Il appartient alors au Bureau des Longitudes et à l'Institut après
la démission de Monsieur de Bougainville.
En 1797 (An V) il est élu député de la Seine au Conseil des Anciens sous le nom
de Claret-Fleurieu. Il y reste deux mois car le coup d'état du 18 Fructidor l'en
exclu.
Il doit vendre ses livres et collections géographiques, à cette occasion le
catalogue qu'il avait dressé de sa bibliothèque est publié.
Portrait de Napoléon en Premier consul, à droite la plaque de Grand Officier de la LH
Sous le consulat et l'empire
Le 24 décembre 1799 Fleurieu est Membre du Conseil d'Etat Le 30 Septembre 1800, il signe un traité d'amitié et de commerce entre la France et les Etats-Unis à Morfontaine, avec Joseph Bonaparte. Il est à cet occasion ministre plénipotentiaire [3].
Il préside ensuite la section de la Marine[4] et assure à 4 reprises entre 1803 et 1804, l'intérim à la direction du ministère de la Marine.
Multipliant les succès, Charles-pierre est nommé intendant général de la liste civile impériale[5] le 10 juillet 1804.
Le 24 juillet 1805 il passe de grand officier de la légion d'honneur à la dignité
de sénateur. Le premier Août 1805, il est nommé
gouverneur des Tuileries et du
Louvre, le 8 Septembre 1805 il prête serment aux mains de l'Empereur.
Le 2 Février 1806 il est élu l'un des 7 sénateurs qui devaient entrer dans la
composition du conseil d'administration du sénat pour l'année. Il est nommé conseiller d'Etat à vie en 1808
 Le
7 Septembre
1809 il est chargé par Napoléon d'enquêter sur la défaite de trafalgar.
Le
7 Septembre
1809 il est chargé par Napoléon d'enquêter sur la défaite de trafalgar.
Il achève sa carrière en comte d'Empire.
Il
mourra le 18 août 1810 d'une hémorragie cérébrale foudroyante à l'age de 72 ans,
juste après avoir embrassé ses deux filles précise-t-on. Il est mort après 54
ans au service de la France...
En récompense de ses beaux services, Napoléon 1er l'honora de funérailles
nationales et le plaça au Panthéon. C'est l'Abbé Raillon qui le reçu
dans sa dernière demeure et qui fit son éloge, l'Abbé deviendra évêque d'Aix.
Fleurieu aura donc eu un rôle déterminant dans la prospérité de la France dans le domaine maritime et militaire sous Louis XVI. Malgré ses nombreuses découvertes scientifiques et son rôle de mentor dans la conduite de la politique maritime, il reste un personnage encore trop peu connu aujourd'hui. Il est cependant certain en toute objectivité que Fleurieu constitue l'une des clés de la prospérité de la France du XVIII ème siècle!
Ci dessus: Charles- pierre Sous Napoléon
|
Voir la tombe de Charles-Pierre CLARET de FLEURIEU au Panthéon. |
Pour honorer sa mémoire son nom fut donné à la péninsule au sud d'Adélaïde en Australie « La péninsule Fleurieu ». C'est l'explorateur français Nicolas Baudin qui en 1802 cartographie la côte sud de l'Australie qui la nomme ainsi en hommage à l'éminent navigateur
Il se marie le 31 Mars 1792 à 54 ans avec Aglaé-Françoise Deslacs d'Arcambales, et eut trois enfants, un fils mort né en prison avec ses parents en 1794 et deux filles:
Caroline Claret de Fleurieu
Et Louise Camille Charlotte Claret de Fleurieu
Louise se mariera en 1826 avec Adolphe Huguet de Saint Ouen, et ils auront une fille, Charlotte Aglaë de Saint Ouen, née en 1827. Voir la descendance.
Notes
[1]
En proposant,
le 23 Mars 1762, M. de Fleurieu pour ce dernier grade, le ministre
disait au roi:
"il réunit à la conduite la plus sage et à la plus grande application des
connaissances peu ordinaires et les dispositions les plus favorables pour
devenir un officier de distinction. Le commandement de sa compagnie en a fait les
plus grandes éloges, et l'a proposé comme un de ses sujets qu'il convient, pour
le bien du service et pour encourager l'émulation, d'avancer avant leur rang."
[2]
Voir
lettre de nomination de Louis XVI
ICI
[3]
Un ministre plénipotentiaire est le représentant accrédité d'une puissance
étrangère auprès d'une autre qui ne jouit pas du rang d'ambassadeur. On
l'appelle en principe Monsieur (ou Madame) le ministre.
En France, le corps des ministres plénipotentiaires est un corps de
fonctionnaires relevant du ministère des Affaires étrangères et appartenant au
corps diplomatique. Beaucoup de ministres plénipotentiaires sont nommés à des
fonctions d'ambassadeur : ils sont ambassadeur (extraordinaire et
plénipotentiaire) de France en... (et non ambassadeur de France, ce titre étant
une dignité conférée à un très petit nombre de ministres plénipotentiaires).
[4] dans le Recueil des traités d'alliance, de paix, et de trêve on y voit le
titre de "Président de la section de l'intérieur"
[5] maison de l'empereur
|
SOMMAIRE → LES PERSONNAGES CELEBRES DE LA FAMILLE FLEURIEU → MENU CHARLES-PIERRE CLARET de FLEURIEU→ BIOGRAPHIE |